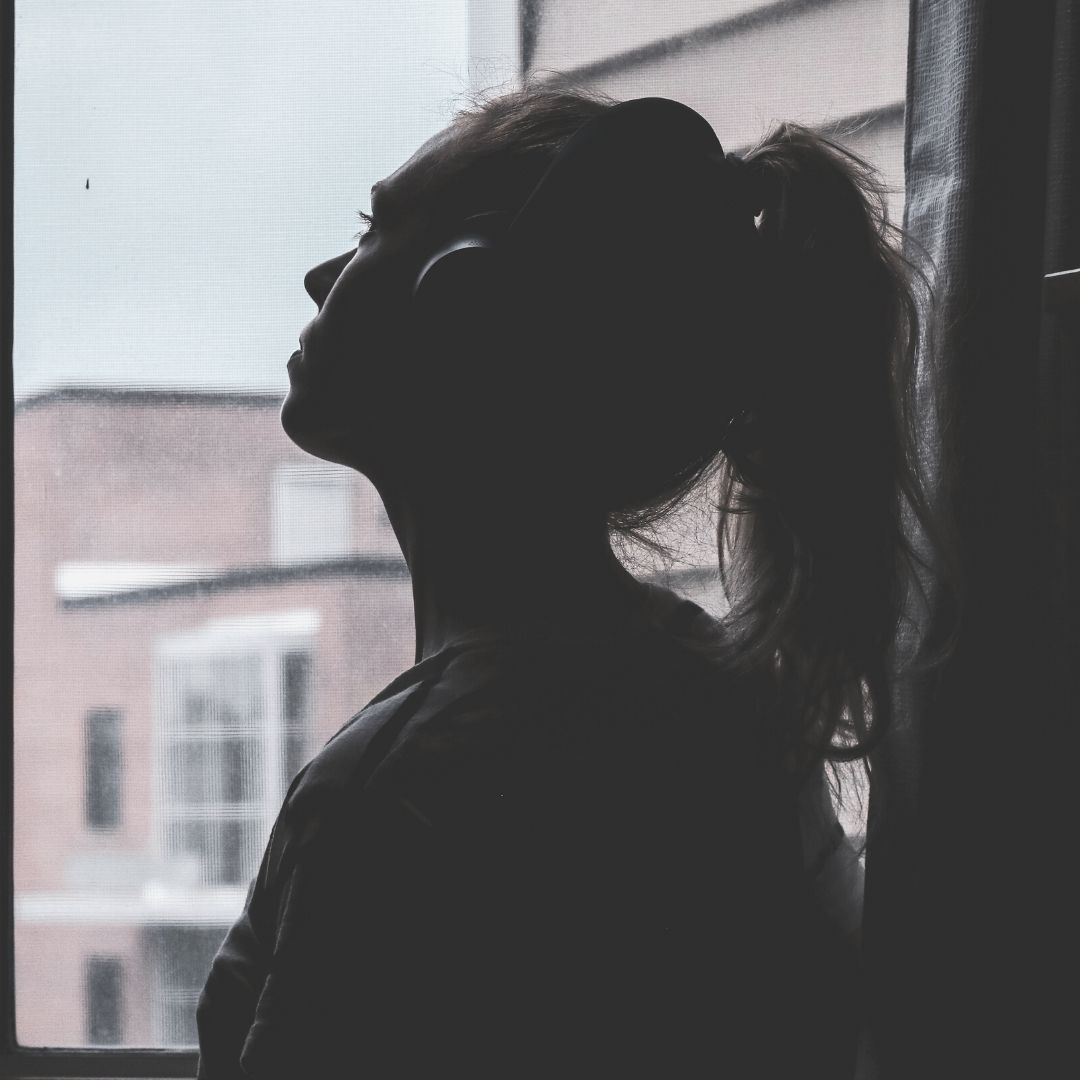RELATIONS AMOUREUSES
Menu corporatif
Collectes de fonds
|||
Relation n.f :
Être, entrer, se mettre en relation(s) avec quelqu’un, le connaître, le fréquenter ou entrer en rapport avec lui.
Amour n.m. :
Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante : Un amour de jeunesse.

Statistiques :
Au Québec, en 2011, 56,4% des personnes de 15 ans et plus étaient en couple. La même année, 29,2% de la même échantillon était considéré comme célibataire.
%
En couple
%
Célibataire
La recette d’une relation
Il existe plusieurs types de relations. Selon Robert Sternberg, un psychologue et professeur en psychologie cognitive,
il y a trois éléments fondamentaux qui composent une relation.
L’intimité
L’intimité représente le lien affectif entre plusieurs personnes. Elle est la composante du partage, c’est-à-dire les moments d’affection, de tendresse, les intérêts communs, la complicité, les partages d’émotions, etc. Donc, l’intimité est la proximité qu’on entretient avec une personne. Bien sûr, cette intimité peut se retrouver en amitié autant qu’en relation amoureuse. On peut observer de l’intimité dans un groupe d’amis également. Souvent, les gens font un lien entre l’intimité et la sexualité, mais ça ne l’est pas.
L’engagement
L’engagement se définit à long terme et à court terme. C’est-à-dire la décision de commencer une relation (court terme) et de maintenir une relation (Long Terme). C’est l’aspect des relations qui comprend tout l’aspect du mariage, des décisions prises en couple. Donc, c’est le moment où deux personnes choisissent de s’afficher en tant que couple et aussi le moment où deux personnes choisissent de se marier.
La passion
La passion représente le lien physique que deux personnes entretiennent. Il s’agit de l’état amoureux, l’attirance, le désir et l’acte sexuel. Donc, la sexualité sera définie par le lien de passion entre différents individus et non l’intimité.
Voici ci-dessous, les différents types de relations selon Sternberg et ce qui les compose.
| Relation | Intimité | Engagement | Passion |
| Non-amour | – | – | – |
| L’attirance | – | – | X |
| La complicité | X | – | – |
| L’amour vide | – | X | – |
| L’amour fou | – | X | X |
| L’amour romantique | X | – | X |
| L’amitié | X | X | – |
| L’amour accompli | X | X | X |
Non-amour :
Le non-amour est tout simplement lorsqu’il n’y a aucune des trois composantes. Il n’y a aucun lien d’attachement, aucun engagement, ni d’attirance. Le non-amour est une relation neutre. Il peut s’agir d’une relation avec de purs inconnus.
L’attirance :
L’attirance est le type de relation ou la passion enest l’unique composante. Comme vu plus haut, la passion représente l’attirance physique et sexuelle. Donc, dans ce cas-ci, il s’agit uniquement d’une attirance envers une personne. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres composantes ne peuvent pas venir s’y ajouter avec le temps. Ou encore, on peut remarquer ce type de relation lors des aventures d’un soir.
Complicité :
La complicité est souvent vue dans les relations professionnelles, comme un thérapeute avec son patient. Le patient va se confier au thérapeute, lui parler de ses émotions profondes sans nécessairement ressentir de proximité physique ou de ressentir le besoin de s’engager avec cette personne.
L’amour vide :
L’amour vide se présente lorsque l’engagement en est l’unique composante. C’est un moment qui peut venir avec le temps, lors des relations à long terme, lorsque la passion et/ou l’intimité s’effacent. Lorsqu’il s’agit d’amour vide, l’engagement représente le moment où deux personnes ne voient pas l’intérêt de mettre fin à la relation, mais qu’ils n’y sont plus heureux. Donc, on peut y voir une colocation plus qu’une relation en soi.
L’amour fou :
L’amour fou réunit les composantes de l’engagement et de la passion. En effet, l’intimité et la complicité entre les membres du couple n’y sont pas. On peut associer cet amour à une dépendance affective. Par peur d’être abandonné par l’autre, l’engagement est plus rapide et moins réfléchi. Donc, ils vont idéaliser leur partenaire sans nécessairement rechercher la complicité.
L’amour romantique :
Cet amour est plus souvent observé chez les plus jeunes. L’amour romantique est constitué d’intimité et de passion, mais l’engagement n’en fait pas partie. C’est-à-dire, que les deux amoureux seront liés émotionnellement et auront un amour passionné également, sans ressentir le besoin de s’engager à long terme. Ils vivront leur amour, mais vivront également des choses séparément.
L’amitié :
L’amitié est le type de relation où les composantes présentes sont l’intimité et l’engagement. Comme expliqué plus haut, l’intimité se présente comme un lien affectif, sans nécessairement être romantique. L’amitié se présente quand deux personnes s’engagent dans une amitié et partagent des intérêts communs et qu’un lien de confiance est établi. Ce qui différencie l’amitié des autres relations, c’est l’absence de passion. Il n’y a pas d’attirance physique ou sexuelle lorsqu’il s’agit d’amitié. Cela peut différer d’une personne à l’autre.
L’amour accompli:
L’amour accompli pourrait aussi être décrit comme étant le type de relation idéale. On peut dire d’une relation qu’elle est accomplie lorsque les trois composantes sont présentes de manière équilibrée et constante.
Relation saine VS relation malsaine
Outre les différents types de relation, il y a deux types fondamentaux de relations : les relations saines et les relations malsaines. Ces deux types contiennent également des composantes qui les définissent. Dans une relation, la remise en question est importante pour être en mesure d’évaluer si la relation est saine ou non.
Relation saine :
Il y a quelques éléments importants qui indiquent qu’une relation est saine. Certains de ces éléments ne viennent pas lorsque la relation commence, ils viennent avec le temps et les efforts mis dans la relation. Voici la recette d’une relation saine :
L’authenticité :
L’authenticité est observée lorsqu’il y a un sentiment d’aise avec le partenaire. Dans une relation, l’un ne devrait pas ressentir le besoin de changer sa personne pour plaire à l’autre. De plus, ne sachant pas si la relation marchera à long terme, il serait frustrant pour la personne en question, ainsi que son entourage, de voir les changements drastiques pour une relation qui n’est peut-être pas faite pour durer. Dans tous les cas, il faut rester soi-même dans une relation et avec son partenaire, car l’intérêt d’une relation est d’accepter l’autre tel/le qu’il/elle est. Lorsque l’individu se sent bien dans une relation, il ressent l’opportunité d’être lui-même avec l’autre.
L’honnêteté :
L’honnêteté consiste à faire part à l’autre de ses inquiétudes et de ses émotions. C’est comme ça que le lien de confiance mutuel se bâtit. Lorsque la personne est en mesure de partager ses pensées avec son partenaire, cela veut dire que l’honnêteté est présente dans le couple.
La bonne communication :
Il est souvent mentionné que la communication est la clé dans un couple. Avec de la facilité à parler des choses importantes pour soi et de choses que l’on ressent et primordial. Elle permet d’éviter des conflits et des malentendus et aide également à la confiance mutuelle. Attention, une bonne communication ne signifie pas seulement de nommer les choses, mais aussi d’écouter attentivement ce que l’autre a à nommer également.
Le respect :
Respecter l’autre dans le couple, c’est de respecter ses craintes et de les écouter avec attention et sans jugement. Le respect signifie également de respecter ses propres limites et de ne pas accepter des choses qui ne nous plaisent pas et/ou qui nous rendent mal à l’aise.
Le sentiment de sécurité :
Le sentiment de sécurité dans un couple est lorsque la personne ne se sent pas en danger en présence de l’autre. Ne pas se sentir menacé ou ne pas avoir constamment l’impression de devoir mâcher ses mots est signe qu’on se sent en sécurité avec l’autre et qu’on ne craint pas de fortes réactions imprévisibles.
La confiance :
La confiance mutuelle dans un couple est un des piliers d’une relation solide et durable. Elle signifie d’être en mesure de parler à notre partenaire sans avoir peur de sa réaction et sans retenue, savoir que nos paroles seront accueillies avec bienveillance et sans jugement. Ensuite, elle se décrit par la confiance d’une personne que son partenaire sera honnête avec elle et parlera avec sincérité.
L’égalité :
L’égalité dans une relation consiste à ce que chaque membre de la relation fasse des efforts de manière égale et équitable. Il n’y a pas de rôle de pouvoir plus présent que l’autre. Parfois, il arrive que l’une des personnes dans la relation fasse plus d’efforts que l’autre, il serait peut-être idéal de se demander si cela est équitable et si les partenaires sont sur le même pied d’égalité. Sans diriger le pas en tout temps, il est possible que l’un fasse plus d’efforts monétairement pendant un temps, pour une raison « x » et que l’autre en fasse plus tard dans la relation. Les efforts peuvent varier, tant que cela ne devienne pas constant dans la relation.
Le soutien :
Le soutien est également l’un des piliers d’une relation saine. Si l’un des partenaires entame un projet personnel, les encouragements de l’autre vont solidifier le lien qu’elles partagent. S’il la personne semble fermée aux cheminements personnels de l’autre et ne semble pas avoir d’intérêt en ce qui passionne son partenaire, il serait peut-être important de valider avec l’autre si elle a envie d’offrir son soutien.
Relation malsaine :
Il y a des comportements à observer chez l’autre dans une relation, qui pourraient être signe d’une relation malsaine. Bien entendu, il faut évaluer les comportements de son partenaire, afin de juger si la relation est saine ou malsaine. Voici des comportements qui peuvent indiquer une relation malsaine :
La violence physique :
Coups, morsures, tirer les cheveux de l’autre, briser des objets sont tous des exemples de violence physique. Il existe également plusieurs types de violence, plus bas dans le document, des ressources sont écrites pour plus d’informations sur la violence conjugale dans le couple et les différents types de violence.
Le contrôle :
Le contrôle dans une relation se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, lorsque le partenaire décide de ce que l’autre doit porter ou encore le fait de vouloir savoir constamment les moindres détails des endroits où l’autre va, avec qui, pendant combien de temps…
C’est le désir de tout contrôler de l’autre et de prendre toutes les décisions à sa place sans lui donner la possibilité de donner son opinion. L’autre doit se plier aux volontés. Le contrôle peut aller jusqu’à isoler l’autre de son entourage, sa famille, ses amis, etc. C’est d’avoir quelqu’un qui est constamment au fait de nos moindres faits et gestes.
L’humiliation :
L’humiliation veut dire de rabaisser constamment son partenaire et surtout quand d’autres personnes sont présentes à ce moment-là. Il s’agit de nommer des choses personnelles qu’on ne souhaite pas être dévoilées ou encore, tout simplement, de se faire insulter devant d’autres personnes.
L’imprévisibilité :
L’imprévisibilité dans le couple est considérée comme étant un indice de relation malsaine, car elle crée un sentiment d’insécurité et de stress chez l’autre. C’est de ne pas savoir comment va réagir son partenaire à chaque fois qu’on doit lui parler de quelque chose. C’est une impression de constamment marcher sur des œufs en présence de son partenaire.
La pression :
La pression veut dire que le partenaire impose des choix à l’autre. C’est, par exemple, de dire à l’autre que s’il ne nous choisit pas, que c’est sûrement parce qu’il ne nous aime pas vraiment. Donc, la personne aura un choix à faire, souvent entre ses valeurs, les choses auxquelles elle tient et son partenaire qui demande toute l’attention. C’est également de donner un ultimatum à l’autre.

Les conflits
Les conflits font partie de la réalité des couples. Ils sont souvent considérés comme étant négatifs, mais peuvent contribuer à la communication entre les deux individus du couple. Il peut arriver que les membres d’un couple ne soient pas d’accord sur tout et ne partagent pas les mêmes opinions. Il y a des moyens utiles pour gérer une situation de conflits et voici quelques outils qui peuvent aider à communiquer plus facilement avec notre partenaire ou encore à gérer ses émotions à ce moment-là.
Premièrement, prendre le temps de décompresser avant de discuter :
Discuter lorsqu’on est submergé par les émotions, ce n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi il est conseillé de nommer à son partenaire que nous ne sommes pas en mesure de discuter pour le moment et que nous avons besoin de prendre une pause. On peut également proposer de discuter par la suite lorsque la tension sera plus basse et que l’état d’esprit sera plus calme. Nommer les émotions ressenties à ce moment-là est très favorable à la compréhension de l’un et l’autre. Si l’un des partenaires propose de discuter, mais que l’autre n’est pas prêt, il faut nommer que le moment n’est pas encore tout à fait bon, mais qu’il fera un retour plus tard. Lorsque les deux partis sont prêts à discuter, le moment est bon pour le faire tranquillement.
Deuxièmement, parler au « Je » :
La formulation des phrases est très importante dans la résolution de conflits. Parfois, l’emploi de certains mots peut complètement changer l’intention du message. Lors des moments de colère, on a tendance à utiliser le « tu » accusateur. C’est-à-dire…
« Tu ne t’occupes jamais de moi » ou « Tu passes tout ton temps avec tes amis »
Il est possible de modifier ces phrases en utilisant le « je »…
« Je me sens délaissé, ça me fait de la peine. »
En parlant au « tu », on ressent dans la phrase de l’accusation, comme si l’on se faisait pointer du doigt. Tandis qu’en « je », on voit une expression des émotions ressenties par la personne, il n’y a pas de ton accusateur dans la formulation de la phrase. C’est un moyen qui rend l’expression de ses émotions plus faciles et plus claires pour l’autre personne.
Troisièmement, cibler la source du conflit :
Lors d’un conflit, il faut cibler quelle en est la source. Lorsque chacun est calme et que les deux partis ont nommé leurs émotions, il est possible de voir ensemble quel était l’élément déclencheur du conflit, puis de trouver des pistes de solution. Toujours en nommant ce qui a été l’élément irritant de la situation pour chacun. Comme mentionné plus haut, l’authenticité consiste à être transparent avec l’autre en ce qui concerne nos émotions. C’est un bon moment où les partenaires partagent leurs points de vue et leurs émotions. La communication sera plus facile dans le couple et le lien de confiance plus fort.
Quatrièmement, écouter l’autre :
Comme mentionné plus haut, lorsque les deux partis sont prêts à parler, chacun peut nommer ce qu’il a ressenti. Mais il faut également écouter ce que l’autre a à dire. La communication ne se fait pas seulement sur l’échange, mais sur l’écoute aussi. C’est pourquoi il faut s’assurer d’être prêt à éventualité que l’autre ait des choses à nous dire et d’être en état d’écouter attentivement. Sans couper la parole, écouter sans jugement. Montrer son écoute attentive au partenaire favorise au lien de confiance qu’il y a entre les deux individus. Il est possible de choisir un temps de parole pour chacun, de manière que chacun puisse parler, de manière équitable et égale.
Cinquièmement, une chose à la fois :
Il peut y avoir plusieurs éléments déclencheurs qui mènent à un conflit, mais il faut faire attention, car régler plusieurs choses en même temps, c’est difficile. Il est plus simple de prendre le temps de régler une chose à la fois, pour être en mesure de nommer et de trouver des solutions qui conviennent aux différents partis. Il est possible de faire une liste des choses qui ont dérangé et de vous accorder du temps de pause entre chaque élément.
Sixièmement, s’excuser et accepter les excuses :
Il se peut que le conflit ne soit pas déclenché volontairement par l’un des partenaires, mais il arrive souvent que, sous l’impulsion de la colère, les amoureux disent des choses blessantes à l’autre. C’est pour cela qu’il est important que tous les partis se demandent pardon à la fin du conflit et qu’ils soient en mesure d’accepter les excuses de l’autre. Demander pardon et pardonner est une bonne manière de démontrer qu’on tient à l’autre et qu’on est prêt à faire des efforts.
Codépendance n.f. :
État de dépendance affective d’une personne à un proche malade ou qui souffre de dépendance.
Qu’est-ce que c’est?
C’est le besoin d’être important et nécessaire dans une relation avec une personne.
Dans une relation où il y a codépendance, on retrouve:
- Un partenaire avec une problématique quelconque. (Consommation, traumatisme, trouble mental, etc.)
- Un partenaire codépendant. (Sauveur)
Le partenaire ayant une problématique va avoir une emprise sur la personne codépendante, car celle-ci veut à tout pris se sentir nécessaire à l’autre, donc elle fera tout en son possible pour être présente pour l’autre, même jusqu’à mettre de côté ses propres besoins. On va considérer que la relation entre ces deux individus est «dysfonctionnelle». La personne codépendante va être pleinement consciente de ses besoins, mais va les mettre de côté constamment, elle fera du déni en ce qui concerne ses besoins et aura de la difficulté à prendre du temps pour elle.
Il existe plusieurs profils de personnes qui sont plus susceptibles de vivre de la codépendance dans leurs relations amoureuses:
- Les personnes étant dépendantes.
- Les personnes étant hyperempathiques.
- Les personnes ayant un comportement évitable.
- Les personnes considérées comme performeuses.
- Les personnes considérées comme sauveuses.
- Les personnes indécises.
Comment observer la codépendance?
En 1986, le psychiatre Timmen L. Cermak a publié un article sur la codépendance, expliquant les différents critères observés chez une personne qui manifeste une attitude codépendante dans ses relations:
- Il est possible de remarquer que la personne obtient de l’estime de soi ou de la valeur personnelle en endurant une relation malsaine. Elle fera passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Elle aura constamment besoin d’être nécessaire à l’autre.
- La personne concernée pourrait constamment ressentir de l’anxiété, ainsi que de la confusion en ce qui concerne les différents territoires. Elle aura de la difficulté à se voir comme une personne à part entière et de voir les autres individus comme des personnes séparées. La personne vivra sa propre existence à travers la personne dont elle est codépendante.
- Grande difficulté à mettre ses limites, même dans les situations qui lui causent de l’inconfort ou de l’anxiété. Elle sera dans le déni en ce qui concerne ses propres besoins.
- La personne aura une incapacité également à nommer ses émotions, encore une fois pour mettre les besoins de l’autre avant les siens.
- Il est possible également de remarquer de l’hypervigilance. La personne portera une attention très particulière à tout ce qui entoure sa relation, afin que tout se passe bien. Elle exercera également un contrôle sur tout ce qui l’entoure. Il est possible de remarquer l’apparition de comportements compulsifs chez la personne codépendante.
Codépendance et dynamiques familiales
La codépendance prend en considération les dynamiques familiales toxiques et dysfonctionnelles.
- Déni des besoins de l’enfant
- Manque au niveau de la communication
- Dynamique avec un ou des parents avec des problématiques. (Consommation, troubles mentaux, etc.)
Ces dynamiques font en sorte que les besoins fondamentaux de l’enfant ne sont pas assouvis. Il faut également se rappeler que les modèles principaux de l’enfant sont les parents avant tout. Dans une dynamique familiale comme celles-ci, on peut remarquer qu’il y a beaucoup de choses non dites, des tabous ou manques de confiance. Malheureusement, même si tous ces points peuvent être observés d’un point de vue extérieur à la dynamique familiale, on retrouve souvent du déni de la part des membres de la famille, croyant que tout va bien.
Pour un enfant vivant avec un parent ayant une problématique quelconque, il est possible que l’enfant se retrouve dans une posture de parentification. L’affection est inconstante dans ce type de dynamique familiale, donc l’enfant fera tout pour recevoir cette part d’affection. On parle de parentification lorsqu’un comportement est répétitif (s’occuper des frères et des sœurs, faire à manger, faire le ménage), afin de recevoir de la reconnaissance de la part du parent. Dans les situations de parentification chez l’enfant, on peut voir celui-ci obtenir le profil d’un sauveur ou encore d’un hyper performeur, ce qui augmente les risques de codépendance dans les relations à venir.
Les défis pour chacun des partenaires
Dépendant
Se laisse envahir par l’inconfort et les difficultés.
Tendance à fuir dans l’excès.
Est insécure.
Tend vers l’égocentrisme.
Codépendant
Prend tout en charge.
Ne respecte pas ses propres limites.
Se perd à chercher des solutions pour prendre soin de l’autre.
Difficultés à ressentir et identifier ses émotions.
Dans le cas des deux partenaires, ils doivent tous les deux trouver l’autonomie affective, afin d’avoir de la bienveillance dans la communication et dans l’ensemble de la relation.
Dans le cas de la personne dépendante, elle doit faire preuve d’humilité et admettre ses difficultés pour être mieux accompagnée vers le chemin de l’autonomie affective.
Dans le cas de la personne codépendante, elle doit obtenir la capacité à trouver des solutions et de passer à l’action.

La sexualité
La sexualité représente l’ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l’instinct sexuel. Il faut savoir, en premier lieu, que la sexualité est intime, donc elle appartient à soi-même. Ce sont les moments où une personne se découvre soi-même dans son intimité. Il y a quelques choses à savoir en ce qui concerne la sexualité, qui pourraient être utiles à chaque individu dans la découverte de soi, ainsi que la recherche d’identité.
La sexualité est différente d’une personne à l’autre :
La comparaison entre les pairs est un comportement souvent observé en ce qui concerne la sexualité. Comme mentionné plus haut, la sexualité diffère d’une personne à l’autre, donc il n’est pas possible de se comparer avec d’autres. Certains individus découvrent leur sexualité plus tôt dans leur vie et souhaitent l’explorer. D’autres ne se sentent pas nécessairement prêts avant un certain âge pour l’explorer, ce qui n’est pas normal ou anormal. Chaque personne est différente et a des besoins différents en ce qui concerne sa sexualité.
Se respecter dans sa sexualité :
Le respect de sa sexualité signifie respecter son rythme. Bien souvent, les gens sont confrontés à une pression sociale ou encore à une pression par les pairs, ce qui peut parfois influencer les décisions de l’individu concerné. Si une personne se presse à explorer sa sexualité et à vivre des expériences sexuelles, alors qu’elle ne se sent pas suffisamment prête ou à l’aise, il se pourrait que ses expériences ne soient pas aussi satisfaisantes.
Les relations sexuelles :
Les relations sexuelles viennent avec le temps dans une relation. Elles viennent au moment où les deux partenaires se sentent prêts à explorer leur sexualité commune. Il est possible que l’un des partenaires soit prêt et que l’autre ne le soit pas encore tout à fait ou vice-versa. Respecter le rythme de l’autre fait partie des composantes d’une relation saine. Avoir des craintes face à sa sexualité est normal, il ne faut pas avoir peur ou honte de nommer ses craintes à son partenaire. Une bonne communication entre les deux partis aide à la confiance en soi et la confiance en l’autre. Alors, il est possible de trouver des pistes de solutions et d’être rassuré par l’autre.
Il est également possible qu’une personne n’éprouve pas le désir ou l’envie d’avoir une relation sexuelle. Il se peut que cela vienne avec le temps ou que la personne ne ressente jamais ce besoin. C’est une chose qui est probable et normale, car chaque personne est différente et la sexualité varie selon l’individu.
Monogamie ou polygamie ?
Nous vivons dans une société où la monogamie est plus fréquente. La monogamie représente l’union de deux personnes exclusivement. Les personnes monogames n’auront qu’un seul partenaire et n’éprouveront pas l’intérêt d’aller voir ailleurs.
Cependant, la polygamie (ou polyamour) est un mode de vie, qui consiste à ce qu’une personne ait plusieurs partenaires amoureux. D’ailleurs, le polyamour est de plus en plus observé de nos jours à travers le monde et est plus accepté dans la société. Dans une relation polyamoureuse, tous les partenaires sont en relation en commun accord, on ne parle pas d’infidélité. Toutefois, il y a encore certains jugements et tabous en ce qui concerne la polygamie.
Monogamie ou polygamie ? Aucun des deux n’est meilleur que l’autre. Tout dépend des valeurs véhiculées par la personne et de ce qui lui convient. L’un n’apporte pas plus de bonheur que l’autre. Encore une fois, c’est un choix qui appartient à chacun, donc qui ne peut être décidé par les autres ou son partenaire. Comme dans n’importe quel type de relation, respecter ses limites et les nommer sont essentiels à une relation saine.
Une orientation sexuelle ? C’est quoi ça ?
L’orientation sexuelle, tout comme l’ensemble de la sexualité, est une chose qui diffère d’une personne à l’autre. L’orientation sexuelle est l’attirance, le désir sexuel et romantique qu’un individu va ressentir envers un certain genre de personne. Chaque personne a une ou plusieurs orientations sexuelles. Il existe dix-sept orientations sexuelles différentes. Les orientations sexuelles peuvent changer avec le temps. Pour certains, l’orientation sexuelle est claire dès la naissance, mais pour d’autres, elle vient avec le temps et l’expérience.
Identité de genre ?
Lorsqu’on parle de sexualité, on va parler d’identité de genre aussi, car elle fait partie de nous. La période de l’adolescence est une période de la vie où les questionnements sont nombreux et où l’adolescent est à la recherche de son identité. L’identité de genre définit la personne que nous sommes à l’intérieur de soi. Elle va au-delà du sexe biologique assigné à la naissance, elle représente un sentiment et une conviction. Il y a en tout six identités de genre :
- Cisgenre : Une personne étant « cisgenre » est une personne qui s’identifie au sexe assigné à la naissance.
- Transgenre/Transsexuel : Une personne « transgenre » est une personne qui ne s’identifiera pas au sexe assigné à la naissance. Cette personne aura le sentiment et la conviction d’être du sexe opposé à l’intérieur. De nos jours, il est possible de faire la transition de changement de sexe. Certaines personnes n’auront jamais recours à la chirurgie de transition complète, mais s’identifieront tout de même au sexe opposé.
- Queer/Non-Binaire : Une personne « non-binaire » est une personne qui ne s’identifiera pas complètement au genre féminin ou masculin. Certaines personnes se considèrent comme étant neutre en ce qui concerne leur identité de genre, c’est-à-dire, ne vont s’identifier à aucun des deux sexes.
- Androgyne : Une personne « androgyne » est une personne ayant des traits physiques aussi masculins que féminins. Dans ce cas-ci, il est parfois difficile de déterminer le genre de la personne au premier coup d’œil.
- Intersexué(e) : Une personne intersexuée est une personne dont les caractéristiques sexuelles (comme les organes génitaux, les chromosomes ou les hormones) ne correspondent pas aux critères traditionnels de masculinité ou de féminité. Une personne intersexe naît avec des traits physiques qui ne sont pas exclusivement masculins ou féminins, mais qui peuvent présenter un mélange ou des variations de ceux-ci. Donc, il peut être difficile de déterminer le sexe véritable d’un enfant. Il est possible, que la personne intersexuée fasse un choix personnel avec l’âge, tout dépendamment du genre auquel elle s’identifie.
-
Bispirituel (le): Une personne « bispirituelle » est une personne qui aura des qualités et des caractéristiques aussi féminines que masculines. Ce terme est plus couramment utilisé dans les communautés des premières nations. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes bispirituelles dans cette culture. Ce terme est moins utilisé dans notre vie de tous les jours.
La consommation VS les relations sexuelles :
Le lien :
Dans les deux contextes (consommation/relation sexuelle), des effets apparaissent au niveau du cerveau. C’est l’organe que ces deux éléments ont en commun. Dans les deux cas, il y a des étapes au niveau du cerveau :
- En premier lieu, il y a le désir de consommer et le désir sexuel. Bien que ces désirs ne soient pas nécessairement les mêmes, tous deux génèrent une émotion.
- Ensuite, arrive l’anticipation liée à la préparation de l’éventuelle consommation ou acte sexuel. Encore une fois, cela génère une émotion d’excitation à l’idée de l’arrivée de ce moment.
- Par la suite, il y a le passage à l’acte/consommation. À ce moment, le cerveau sécrète de l’adrénaline et de la dopamine, ce qui crée un sentiment de bien-être. Ce qui mène à l’effet recherché (voir plus bas).
- Pour finir, il y a le moment de pause. Le corps sécrète de l’endorphine et tout revient à la normale. Cette pause peut être courte ou encore s’étaler dans le temps. C’est à la personne de décider si elle souhaite recommencer ou non.

Effets recherchés vs effets réels :
Les gens consomment rarement sans raison. La majorité du temps, la consommation est effectuée avec une idée derrière la tête, soit des attentes par rapport aux effets attendus d’une consommation. C’est ce qui définit les effets recherchés par l’individu qui choisit de consommer une substance quelconque. Les gens consomment souvent :
- Par curiosité.
- Pour être en mesure de se dégêner.
- Pour faire comme les autres, appartenir au groupe.
- Vivre de nouvelles sensations.
- Avoir du plaisir.
Ce sont souvent les effets qui sont recherchés par les consommateurs. En revanche, cela ne veut pas dire que les effets recherchés sont des effets qui sont réels. En effet, les effets recherchés ne sont pas des effets réels, ou le sont, mais très rarement. Il faut être prudent en ce qui concerne la recherche d’effets, car les consommateurs ont tendance à consommer d’avantages de substance en imaginant pouvoir finalement atteindre les effets recherchés. Une plus grande quantité consommée pourrait, au contraire, augmenter les effets réels et indésirables (par exemple : crise de larmes, colère, impulsivité, vomissements, coma éthylique, textos inappropriés, révéler ses sentiments à des moments inopportuns).
En ce qui concerne la sexualité, il y a des effets souvent attendus lorsqu’il y a consommation avant le passage à l’acte. Par exemple, il y a attente d’euphorie, d’excitation ou encore de détente ou de relaxation. Cependant, les effets réels et indésirables peuvent venir atténuer le désir sexuel, créer des problèmes au niveau érectile ou à la lubrification. Aussi, il peut y avoir des sentiments négatifs à ce moment-là, comme de l’anxiété, de la peur, de la confusion ou encore de la paranoïa.
Facteurs de risque :
Il existe plusieurs risques face aux relations sexuelles en état de consommation, certaines d’entre elles peuvent être à long terme.
- Jugement altéré : Surtout lors de la consommation d’alcool, on peut observer une altération du jugement chez une personne intoxiquée. Lors des relations sexuelles, l’intoxication peut représenter un risque, car le port du condom est souvent délaissé. Ce comportement à risque peut amener la transmission d’ITSS ou encore peut mener à une grossesse accidentelle. De plus, des regrets peuvent en suivre, lorsque l’individu choisit d’avoir une relation sexuelle avec une personne qui n’aurait pas été considérée en cas normal.
- Consentement : Ensuite, une personne intoxiquée par l’alcool ou de la drogue de manière avancée n’est pas reconnue légalement comme étant en mesure de donner son consentement. Si un acte sexuel s’en suit, la personne ayant attouché ou eut une relation sexuelle pourrait être accusée de viol ou d’agression sexuelle.
Lois :
Écart d’âge :
Même lorsque l’on est mineur, il y a des lois en ce qui concerne les écarts d’âge entre deux individus. Les lois dépendent de l’âge du plus jeune des deux partenaires et changent avec les années.
Si un adolescent a moins de 13 ans
L’âge d’écart légal en ce qui concerne le consentement selon la loi, est de deux ans. Donc si le jeune a 12 ans, il n’est légalement pas possible d’avoir un partenaire de plus de 14 ans. À l’âge de 13 ans, il n’est pas possible d’avoir un partenaire de plus de 15 ans.
Si un adolescent à 14 ou 15 ans
L’âge d’écart légal en ce qui concerne le consentement selon la loi, est de 5 ans. Il n’est pas possible légalement d’avoir un partenaire âgé de plus de 19 ans si le jeune a 14 ans. À 15 ans, il n’est pas possible légalement d’avoir un partenaire de plus de 20 ans.
Si l’adolescent est âgé de 16 ans et plus
Il est reconnu comme étant en mesure de donner son consentement aux activités sexuelles. Donc, âgé de plus de 16 ans, l’écart d’âge ne s’applique plus à celui-ci ou celle-ci. Cependant, il reste quelques exceptions à cette loi :
« Une jeune personne de 16 ou 17 ans ne peut pas consentir à des activités sexuelles si :
- son partenaire sexuel est en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’elle (par exemple, son enseignant ou enseignante ou son entraîneur ou entraîneuse) ;
- la jeune personne est dépendante de son partenaire sexuel (par exemple, pour lui prodiguer des soins ou subvenir à ses besoins) ; et
- la relation qu’elle entretient avec son partenaire sexuel relève de l’exploitation.
Les facteurs suivants peuvent être pris en considération au moment de déterminer si une relation relève de l’exploitation pour la jeune personne :
- l’âge de la jeune personne ;
- la différence d’âge entre la jeune personne et son partenaire ;
- l’évolution de la relation (par exemple : rapidement, secrètement ou par Internet) ; et
la façon dont le partenaire peut avoir contrôlé ou influencé la jeune personne. »
Sources
Les relations saines et malsaines, JEUNESSE J’ÉCOUTE. https://jeunessejecoute.ca/information/relations-saines-et-relations-malsaines/. Consulté le 06 avril 2021.
La dépendance amoureuse, TEL-JEUNES. https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/La-dependance-amoureuse?gclid=EAIaIQobChMI6pePoYHJ7wIVA6_ICh2MnAQ9EAAYASAAEgJbQPD_BwE. Consulté le 06 avril 2021.
Le consentement sexuel, ÉDUCALOI. https://educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel/ Consulté le 08 Avril 2021.
L’âge de consentement aux activités sexuelles, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU GOUVERNEMENT DU CANADA, https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html. Consulté le 6 avril 2021.
Vous êtes curieux?
Nous vous proposons quelques liens et lectures afin d’en apprendre davantage sur le sujet. De plus, visitez nos services afin de voir nos ateliers en lien avec cette thématique. Vous êtes parent ? Nous avons des informations spécialement préparées pour vous.
Liens utiles
Voici quelques ressources informatives auxquelles il est possible de se référer en cas de questionnements.
Tel-Jeunes est un organisme qui offre un service de soutien 24/7 par téléphone, texto, clavardage ou courriel. Vas faire un tour dans les sections Amour et Sexualité de son site !
On parle de sexe est une websérie éducatif conçue en collaboration avec Tel-Jeunes pour approfondir le sujet de la sexualité chez les adolescents. Sur un ton humoristique, c’est un incontournable pour ouvrir la discussion entourant la sexualité.
Jeunesse J’écoute offre aussi un service de soutien 24/7 par téléphone, texto et clavardage. Son site regorge d’une tonne d’informations sur les relations amoureuses.
La Clé sur la Porte est une maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Son site internet offre de l’information sur la violence conjugale.
Le CAVAC (Centre d’aide au victime d’acte criminel) est un service offert à toute personne victime d’un acte criminel, entre autres, les actes criminels sexuels.
Section parents
Aborder certains sujets avec son adolescent n’est pas toujours chose facile, surtout quand il s’agit de la sexualité de notre enfant ou de son exploration sexuelle. Il peut arriver que certains propos nous rendent mal à l’aise. Toutefois, il est important de garder l’esprit ouvert lorsqu’on aborde ces sujets, il se peut que l’émotion nous emporte et qu’on finisse par chicaner notre enfant. Par contre, il est important de savoir qu’il est possible de prendre un pas de recul et de revenir sur nos paroles. Prendre un peu de temps pour voir les choses d’un autre point de vue et faire un retour avec son adolescent est possible et rien n’est perdu.
Par contre, si vous observez que votre enfant adopte des comportements à risque ou ne respecte pas les limites d’une autre personne, il est possible d’intervenir et de diriger son enfant de manière plus directive, afin de le ramener sur le droit chemin. Mais il faut toujours intervenir avec bienveillance auprès de son enfant et non de manière rigide.
La LigneParent offre quelques conseils qui pourront être utiles si vous ne vous sentez pas à l’aise à aborder certains sujets avec votre enfant :
Voir plus loin que les relations sexuelles
Aborder ce sujet avec son adolescent, ne veut pas dire de parler que de la sexualité et de ce qui concerne les relations sexuelles. Il faut voir au-delà de ça, lui parler de l’amour, des relations et du respect. Il est possible, à ce moment-là, d’apprendre à son adolescent à s’affirmer, être en mesure de nommer ses émotions et de respecter ses propres limites, de comprendre d’avantages son corps et comment il fonctionne. L’éducation à la sexualité ne se limite pas aux relations sexuelles, mais il est possible que vous ayez déjà éduqué votre enfant en ce qui concerne la sexualité à maintes reprises. Lorsqu’on dépasse cette idée de la sexualité, il est plus facile d’aborder ces sujets avec son adolescent avec aisance.
Écoutez-vous et respectez vos limites.
Malgré une grande ouverture d’esprit, il est possible que certains sujets ne nous rendent pas à l’aise. Il faut toujours être à l’écoute de soi-même et de ses propres limites. Il n’y a pas de mal à ne pas être en mesure de répondre à tous les questionnements de votre enfant, par contre, il est possible d’aider celui-ci en le référant à des ressources qui pourront répondre à ses questions (par exemple : Livres, site internet de Tel-Jeunes, un autre adulte significatif avec qui votre jeune à un lien de confiance et qui pourrait être à l’aise d’aborder ce sujet).
C’est normal de ne pas tout savoir
Il est possible de ne pas tout savoir en ce qui concerne la sexualité et il ne faut pas avoir honte de nommer que nous ne savons pas tout. Par contre, il est tout de même possible d’accompagner son adolescent dans la recherche d’informations et de proposer son soutien dans ses démarches. En proposant votre aide, cela vous permet d’apprendre à votre ado qu’il est normal de ne pas tout savoir et que vous êtes présent pour lui.
Utilisez des sources externes
Il est possible d’utiliser des exemples de situations qui ne rejoignent pas directement la vie de votre adolescent pour aborder certains sujets. Par exemple, si vous écoutez un film romantique, il est possible de créer une discussion sur les différentes relations observées dans le film, autant du point de vue amical que romantique. Ensuite, avec les nouvelles qui ressortent dernièrement, il est aussi possible d’avoir une discussion pour connaître le point de vue de l’adolescent. En bref, toute occasion est bonne pour informer et renseigner son enfant.
Pas de bonnes ou mauvaises réponses
Il est important de se rappeler qu’il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses lorsque nous entamons une discussion sur la sexualité. Le véritable objectif est d’amener son adolescent à avoir un jugement critique sur différentes situations dans leurs relations amoureuses et affectives. L’adolescent pourra alors prendre des décisions plus éclairées sur les multiples choix qui s’offrent à lui. Un lien de confiance fort entre vous et votre adolescent lui permettra de se rappeler que vous êtes présent pour lui et qu’il peut se confier à tout moment.
L’ouverture : puissant levier face à votre ado
Les premières expériences sexuelles ou amoureuses peuvent paraître effrayantes pour l’adolescent. Cela peut créer un sentiment d’insécurité et des questionnements sur de nombreux sujets. Ne vous inquiétez pas, car si votre adolescent souhaite obtenir des réponses à ses questions, il ira les chercher. Internet, les livres et des personnes qui l’entourent comme un membre de la famille, un ami, un intervenant ou encore un partenaire, il sera en mesure d’obtenir une réponse, même s’il ne vient pas immédiatement se référer à vous. Il y a toujours possibilité de démontrer de l’ouverture face aux discussions, ce qui augmentera les chances que votre adolescent vienne se référer à vous lorsqu’il en ressentira le besoin.
Voici également quelques questions qui pourront permettre à votre adolescent de se questionner sur les différents aspects des relations amoureuses ainsi que de la sexualité :
- « Que penses-tu de la relation entre ces personnages de ta série ?
- Ton amie qui est en peine d’amour, comment prend-elle soin d’elle en ce moment ?
- Ta tante et ton oncle se séparent et cela crée beaucoup de conflits… ça doit être difficile pour ta cousine. Tu en penses quoi ?
- J’ai lu que beaucoup d’ados envoyaient des sextos. Tes amis et toi, vous en pensez quoi, de ça ?
- Selon toi, qu’est-ce qui pousse les adolescents à en envoyer malgré les risques ?
- Quand j’étais plus jeune, on ne savait rien de la contraception. J’ai l’impression que ça a changé. Est-ce que je me trompe ? »
Toutes les informations dans la section Parent ont été trouvées sur le site LIGNEPARENTS. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer directement au site web de l’organisme.
Ateliers scolaires
Secondaire

Relation en cage
Public cible: Secondaire 2 à 4
Objectifs: Aborder le sujet de la dépendance affective ainsi que l’importance de développer de saines relations.
Durée: 75 minutes (1 période)
Descriptif: À l’aide de mise en situation, les jeunes peuvent repérer rapidement les signes d’une relation saine ou malsaine. De plus, ils développeront des techniques de communication non violente.

Sexe, drogues et rock and roll
Public cible : Secondaire 5
Durée : 75 minutes (1 période)
Objectif : Identifier les impacts de la consommation sur les relations intimes.
Descriptif : L’atelier permet aux jeunes d’aborder les impacts de la consommation sur leur jugement, le consentement, la prise de risque lors de relations intimes. Nous survolons les types de drogues et les effets possibles en contexte d’intimité. L’atelier est agrémenté de mises en situation et d’un exercice pratique.
À noter, cet atelier répond à certains éléments du contenu obligatoire en éducation à la sexualité: l’intention éducative 1 : Évaluer les risques d’ITSS et de grossesse associée à divers contextes de la vie sexuelle active. Couvre le point 1.1 : Contexte des relations sexuelles.